LAURE GUÉROULT-ACCOLAS – Tumorectomie, chimiothérapie puis mastectomie et radiothérapie en 2009
Entretien en octobre 2018

Je m’appelle Laure Guéroult-Accolas, j’avais déjà eu une biopsie à 25 ans, qui n’avait rien signalé de sérieux, et j’avais gardé l’habitude, comme on déménageait beaucoup, en France puis à l’étranger, de faire un contrôle gynéco en France l’été quand je rentrais pour les vacances.
Cet été là, l’été de mes 39 ans, comme d’habitude, je suis allée contrôler chez le gynéco ce qui se passait et finalement, il y a eu à faire une mammographie, qui a signalé qu’il fallait faire une biopsie. Et je dirais qu’à ce moment-là, ça ne m’a pas inquiété plus que ça, puisque j’avais déjà eu une expérience de contrôle précédent. Début août donc – ce n’était pas mon médecin puisqu’elle était en vacances –, j’ai appris à 9 heures du matin avec un médecin que je connaissais pas – ce n’était pas mon médecin puisqu’elle était en vacances –, qu’en fait c’était un cancer du sein. Evidemment ça a été un choc, parce que, à 39 ans, on ne s’y attend pas, mais en même temps j’ai vécu comme une chance le fait de l’avoir trouvé assez tôt.
J’ai compris tout de suite en fait que les choses étaient un peu plus sérieuses que ce qu’on m’avait initialement annoncé, et donc du coup j’ai fait des chimiothérapies, puis une ablation du sein, et des rayons par la suite. Et deux ans après, j’ai fait le choix d’une reconstruction.
Ma maman avait eu un cancer du sein peu de temps avant, donc finalement elle a été un peu mon « coach en cancer », parce qu’elle avait eu chirurgie, curage, chimio. Donc, j’avais un exemple devant moi du parcours de soins et de comment ça pouvait se passer, mais maman a été touchée quand elle était à la retraite.
Pour moi, on était en plein déménagement, pour un nouveau pays : donc comment on s’organise ? Comment on gère le quotidien ? Ca a été finalement beaucoup d’organisation, beaucoup d’anticipation, essayer de savoir ce que je pouvais faire, en France, pour me soigner, et ce que je pourrais faire en Turquie, pour me soigner et être proche de ma famille, puisqu’on n’a pas souhaité remettre en questions nos projets ; ça a été très compliqué et sincèrement j’ai été finalement assez seule, soutenue par ma famille, mais pas tant que ça par l’équipe médicale.
Se soigner à l’étranger
En fait ce qui m’a rassurée, c’est que j’avais la chance d’avoir un oncle radiothérapeute qui avait eu l’occasion de beaucoup voyager et travailler avec des équipes internationales, et qui m’a dit : « mais tu sais, il n’y a aucun problème, la radiothérapie, tu pourras la faire en Turquie, ils sont largement aussi bien équipés que dans nos centres français, c’est très standardisé, il n’y a pas de soucis ».
Donc, ça m’a permis de dire à mon équipe de soins en France que je souhaitais que ça soit la France qui soit le pôle de décision de toute mon parcours de soin, mais par contre que je souhaitais faire un maximum de chimio et puis les rayons en Turquie. J’ai trouvé finalement que c’était un peu compliqué à mettre en place parce que les équipes soignantes en France ne sont pas très habituées à ce qu’on prenne un peu, et pas tout. Ils avaient presque l’impression que je mettais en doute, ce n’était pas ça, c’était que j’avais envie d’être au maximum auprès de ma famille. Donc j’ai trouvé qu’ils avaient un peu de mal à me lâcher, entre guillemets, et à me laisser m’organiser comme je voulais, mais ça a été possible finalement.
En Turquie, ce qui a été difficile, c’était l’isolement parce que je pouvais parler anglais – je ne suis pas une championne en anglais – avec mes médecins, un peu avec les infirmières, mais elles n’étaient pas toujours à l’aise ; je n’ai pas beaucoup échangé avec les patientes en Turquie, donc c’était un peu tristounet de prendre sa voiture, ou un transport, et aller en soin et d’être vraiment toute seule quoi. Ça, ce n’était pas très cool.
Mes enfants et ma maladie
Ce qui a été très compliqué, c’est que j’avais pu annoncer à mes enfants, qui étaient quand même assez jeunes, qu’on allait s’occuper de ce cancer, que comme avec grand-mère ça allait bien se passer, et que j’allais me faire opérer, qu’après on ferait quelques rayons, et que ça serait fini. Et là il a fallu leur redire toujours la vérité, mais une vérité qui était plus embêtante. Du coup, ça a été compliqué, ça a créé beaucoup d’angoisses parce que je suis retournée en France pour faire mes premières chimio de chaque cycle – j’avais comme beaucoup de femmes deux types de chimio à prendre –, donc c’était compliqué de faire la navette, d’expliquer ça aux enfants, qui étaient déboussolés par tous ces changements.
J’avais l’impression de faire le mieux possible pour eux, et j’ai réalisé qu’en fait ça ne collait pas. Et là aussi, on a eu une chance formidable : dans l’école dans laquelle ils étaient, une école internationale, il y avait une psychologue scolaire, qui était là à temps plein, parce que pour ces enfants qui bougent dans le monde entier, il y a quand même des moments de transition compliqués. Et notamment pour les deux plus jeunes c’était difficile, et un jour, l’école m’a appelée d’urgence en disant : « écoutez, il faut que vous veniez, il faut qu’on parle, parce que votre petite fille, ça ne va pas »
A un moment donné, elle pleurait beaucoup, elle ne voulait plus aller à l’école, elle ne voulait plus manger, donc quand même c’était préoccupant. En travaillant avec cette psychologue, on a compris qu’elle avait très peur que je meure ou que je disparaisse pendant qu’elle était à l’école. Donc il y avait cette idée que maman partait, et elle ne savait pas si j’allais revenir, elle avait très peur que je disparaisse, et donc elle ne pouvait pas me dire à moi qu’elle avait peur que je meure : c’est ça que j’ai compris à l’aide de cette psychologue, à elle elle a pu le dire, et du coup, ça a permis de mettre en place tout simplement une sorte de deal avec ma petite fille, entre la psychologue, le maître d’école et elle, qui était de dire : « Si tu veux appeler maman, tu as toujours le droit d’appeler, tu peux partir n’importe quand, du cours, de l’activité, tu vas au secrétariat, et tu peux appeler maman pour t’assurer qu’elle va bien et parler avec elle ». Et donc elle a dit : « D’accord, on va faire comme ça », « d’accord, je retourne à l’école ». Les premiers jours, elle m’a appelé très souvent, et puis plus ça allait, plus elle a gagné en confiance : quand elle était à l’école, maman faisait des choses mais maman était là et ça allait.
Pour moi, je n’avais pas besoin de psychologue, pas besoin de soutien, j’avais 39 ans. Dans ma famille il y a eu plein de problèmes de santé, je me sentais capable de faire face, j’étais bien épaulée en terme d’organisation, et en fait je n’avais pas compris à quoi ça pouvait servir de faire appel à l’aide d’un psychologue, enfin en tout cas pour les enfants et probablement aussi pour moi, pour comprendre qu’on a beau aimer sa famille du fond du cœur, on n’est pas toujours la personne la mieux placée quand on est soi-même malade. Et quand finalement, on leur pose un certain nombre de problèmes avec cette situation, on n’est pas les mieux placés pour les aider et les accompagner, et l’amour ne suffit pas.
Du coup, ça m’a beaucoup appris parce que ça a été extrêmement efficace de pouvoir poser les choses avec un professionnel et de mettre en place des solutions concrètes pour aider, en l’occurrence ma petite fille à ce moment-là, ou mieux comprendre mon petit garçon qui était un peu plus grand, qui avait 9 ans. Lui, il était extrêmement agressif, normalement il était mignon comme un cœur. Donc elle m’a aidée à comprendre son ressenti et pourquoi il réagissait comme ça : et là en fait, cette agressivité, il l’avait beaucoup envers moi, mais il l’avait aussi beaucoup à l’école, je crois qu’il a passé une année cauchemardesque.
Il y a plein de choses que je ne savais pas, que j’ai apprises des années après et qui m’ont beaucoup touchée d’ailleurs, il a été vraiment malheureux. Ce que m’a expliqué la psychologue à ce moment-là, c’est que ce petit garçon qui arrivait dans un pays, où il parlait assez bien anglais, mais ne parlait pas turc, il n’avait pas de copains, il arrivait dans cette nouvelle école, sans copains, avec une maman qui avait quand même une drôle de tête, qui était fatiguée, qui ne pouvait pas faire tout comme les autres mamans, qui ne pouvait pas forcément venir, puisque j’étais à l’hôpital en chirurgie, pour les réunions de rentrée etc… J’avais raté des choses qui étaient un peu fondamentales pour le démarrage de cette année scolaire, et du coup il était furax. Il avait honte de mon look, en fait, ça ne lui plaisait pas, c’était trop dur, donc il tabassait un peu tout le monde, il était agressif. Je comprenais que c’était vraiment difficile, qu’il avait besoin de relais, par exemple de ses grands-parents ou d’autres adultes, et que ce n’était pas grave, qu’il fallait lui donner un petit peu de temps pour digérer tout ça.
Un nouveau projet de vie
En rentrant en France, j’avais donc 42 ans. J’avais écouté plein de conférences sur le retour au travail des expatriés, des malades, souvent on vous dit : « Il faut bien cacher les trous, il ne faut pas dire que vous êtes parti, que vous vous êtes arrêté, que vous avez été malade ». En fait, je n’avais pas envie de ça, je me suis dit : « J’ai été malade, certes, mais je vois pas en quoi ça me rend moins performante, loin de là en fait ». Je n’avais pas envie de cette espèce de tricherie, et je n’avais pas non plus envie de me prendre trop de « baffes ». Me faire entendre dire que j’étais finalement trop vieille ou autre, alors que je pense qu’on a des vies qui sont longues et qui peuvent avoir pleins d’étapes.
Du coup, j’ai retrouvé un copain de promo qui avait une agence de communication santé et c’est en échangeant avec lui sur ce que j’avais vécu, les besoins que j’avais ressentis, qu’on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire dans ce monde-là, du digital, de l’accompagnement des patients. C’est avec lui qu’on a monté le concept, on a regardé ce qui se passait au Canada, aux États-Unis, parce que dans le monde anglo-saxon, il y a depuis longtemps beaucoup plus d’échanges, de communautés de patients qui ont vraiment un poids important, qui sont bien structurés. On est partis du modèle de réseaux sociaux de ce type en ajoutant notre pâte, nos idées à nous, et c’est comme ça qu’on a créé ce projet « mon-réseau-cancer-du-sein ».
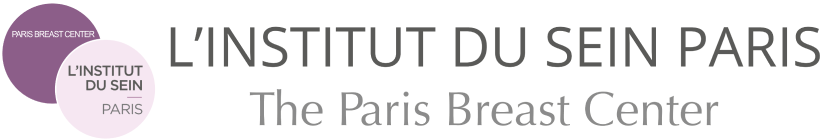


Laissez votre commentaire